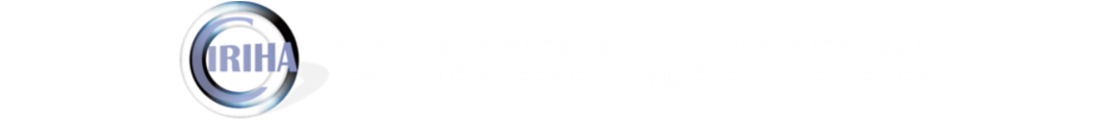La connaissance du « seuil de réactivité », la dose minimale d’aliment qui déclenche une réaction, est importante pour l’individu allergique. Idéalement, il convient également de connaître le nombre d’individus qui réagissent à cette plus petite dose d’aliment.
Ces données sont essentielles tant pour le consommateur allergique que pour les industries agroalimentaires pour l’étiquetage des denrées préemballées.
Il existe des données variables sur la dose minimale d’allergène susceptible de provoquer une réaction clinique.
Détails à consulter au CIRIHA
Les allergies croisées
On retrouve peu de littérature sur les allergies croisées, plus spécifiquement celles entre les protéines du lait de vache et les protéines de mammifères. L’allergie croisée entre protéines de mammifères peut se présenter quand une personne allergique à une de ces protéines présente une réaction allergique lors de la consommation d’une protéine homologue ou identique, présentant les mêmes propriétés structurelles, fonctionnelles et biologiques.
- Il peut y avoir allergie croisée quand :
- deux protéines alimentaires partagent la même séquence d’acides aminés (du moins celle contenant l’épitope : épitopes B conformationnels identiques) ;
- la structure tridimensionnelle d’une molécule la rend similaire à une autre dans sa capacité à lier les antigènes spécifiques (Wal, J.M., 2002; Moneret-Vautrin, D.A. et al., 2006; Restani, P. et al., 1999).
Selon Moneret-Vautrin, un taux d’homologie forte de 70% augmente le risque d’allergie croisée et un taux de 30% l’éloigne (Moneret-Vautrin, D.A. et al., 2006).
Souvent, il y a une forte homologie entre les protéines de vertébrés et donc un plus grand risque de réaction croisée.
Réaction croisée lait de vache et œuf de poule ?
Sur base des séquences d’acides aminés et des trois structures tridimensionnelles, l’α-lactalbumine a une structure proche du lysozyme du blanc d’œuf (Stenton, G.R. et al., 1998). Suite à la présence de l’albumine de poule dans le jaune d’œuf, une allergie croisée au lait de vache et aux œufs de poule avait été décrite par May et al. en 1977. Il semblerait cependant que le site antigénique majeur du blanc d’œuf se situe sur une région où la différence de séquence est la plus importante ; raison pour laquelle il n’y aurait pas réactivité croisée selon un article de 1997 de Paupe et cela même si l’homologie entre l’α-lactalbumine et le lysozyme du blanc d’œuf est de 40 % (Paupe, J., 1997).
Une étude de Diéguez a quand même mis en évidence que les enfants souffrant d’APLV IgEmédiée sont des patients à risque de présenter une allergie à l’oeuf. Le Skin Prick Test (SPT)5 semble être un outil diagnostic satisfaisant pour prévoir les réactions à une première exposition à l’oeuf chez des patients allergiques aux PLV (Dieguez, M.C. et al., 2008).
- Le lait de vache contient un grand nombre de protéines présentant un potentiel plus ou moins important d’allergénicité. Il en est de même pour les protéines de bœuf. Un grand nombre de ces protéines peuvent être impliquées dans une réaction croisée :
- entre des protéines de viandes ;
- entre des protéines de laits d’animaux de différentes espèces ;
- entre des protéines de viande et de lait de mammifères.
Allergie croisée lait de vache et laits d’autres mammifères
Pour les protéines de lait, elles sont au nombre de 20 à pouvoir causer une allergénicité.
Ces allergies croisées entre les laits de différents mammifères sont dues principalement aux protéines qu’ils contiennent, souvent similaires. Comme il a déjà été déterminé lors d’un chapitre précédent, la caséine-α principalement mais aussi, les caséines-β et –γ constituent les protéines allergisantes principales des laits et dérivés. Les caséines α-S1 et α-S2 de la vache, de la chèvre et de la brebis partagent 87 à 98 % d’acides aminés identiques (Bellioni-Businco, B. et al., 1999).
Il semblerait, selon Spuergin, que l’homologie entre les protéines du lait de chèvre et les protéines du lait de brebis soit de 97% alors qu’elle n’est que de 85% pour le lait de vache et lait de brebis et/ou de chèvre (Spuergin, P. et al., 1997).
- En 1999, Restani et al. ont analysé les séquences d’allergènes de protéines de lait de différentes espèces animales.
- Le lait de vache présente 4 bandes majeures : l’α- et la β-caséine, la β-lactoglobuline et l’α-lactalbumine ;
- Le lait de bufflonne présente une composition similaire à celle du lait de vache ;
- Les laits de brebis et de chèvre contiennent une fraction moins importante en caséines ;
- Le lait de chamelle montre des bandes tout à fait différentes de celles du lait de vache. Ce lait contient une grande quantité de caséines et ne contient pas de β-lactoglobuline ;
- La composition du lait de vache est différente de celle du lait de femme de par sa teneur importante en lactoferrine et l’absence de β-lactoglobuline.
L’utilisation de la méthode d’immunoblotting (« immunotransfert ») avec les sérums des 6 enfants allergiques au lait de vache a permis de constater la formation de complexes antigènes-IgE avec tous les laits de mammifères mis à part le lait de chamelle.
Dans cette étude, certains enfants allergiques au lait de vache toléraient le lait de chèvre. De plus, chez 3 des 6 enfants allergiques au lait de vache, les réactions étaient plus faibles lors de l’ingestion du lait de chèvre. Ceci pourrait s’expliquer par la faible quantité d’α-caséines dans le lait de chèvre. Ces résultats ne sont cependant pas représentatifs étant donné la faible quantité de l’échantillon ajouté à des résultats qui tournent autour du 50/50 (Restani, P. et al., 1999).
D’autres auteurs ont étudié ces réactions croisées entre lait de vache et lait de brebis et/ou de chèvre.
En Italie, de nombreux laits infantiles à base de lait de chèvre sont disponibles. Suite à cette observation, Belloni-Businco a réalisé une étude. Vingt-six enfants allergiques au lait de vache et non sensibilisés au lait de chèvre, âgés de 5 mois à 7 ans, ont subi des tests allergologiques (DBPCFC, SPT, dosage des IgE, CAP, SPS-PAGE & Immunoblotting). Ving-quatre d’entre eux ont réagi positivement au DBPCFC (symptômes observés : urticaire, rhinite et/ou asthme, angio-œdème, vomissements). On pourrait supposer que cette réaction est due à l’homologie entre les structures caséiques des différents laits (Bellioni-Businco, B. et al., 1999).
Un rapport de cas décrit une réaction anaphylactique après ingestion de lait de chèvre chez un bébé espagnol de 4 mois allergique au lait de vache. L’allergénicité a été démontrée par critères immunologiques et cliniques (Pessler, F. and Nejat, M., 2004).
Etant donné que les études montrent un grand nombre de cas d’enfants allergiques au lait de chèvre, Businco et al. ont décidé d’étudier la réactivité de 25 enfants allergiques au lait de vache lors de la consommation de lait de jument. Ces enfants, âgés d’un an et demi à 6 ans ont subi des tests allergologiques (SPT, DBPCFC) avec le lait de vache, de jument et un placebo. Tous étaient allergiques au lait de vache mais 4% seulement l’étaient au lait de jument. Lors de cette étude, il a été démontré que les séquences d’acides aminés de certaines protéines du lait de jument diffèrent des protéines contenues dans le lait de vache. Trois différentes sortes d’α-lactalbumines désignées comme A, B et C ont été découvertes. La composition du lait de jument semble donc beaucoup plus proche de celle du lait de femme de par son contenu en protéines, la proportion de celles-ci et la haute teneur en lactose (Businco, L. et al., 2000).
On peut constater par toutes ces études que l’allergie croisée entre le lait de vache et le lait de chèvre et de brebis est existante. Sicherer estime sa prévalence à 92% (cette allergie croisée a été observée chez 92% des 26 patients allergiques aux PLV ayant participé à l’étude) (Sicherer, S., 2001).
Les allergies croisées entre les laits de différents mammifères sont dues principalement aux protéines qu’ils contiennent qui peuvent posséder des similarités.
Allergie croisée lait de vache et viande ovine, bovine et/ou porcine
On retrouve peu d’articles traitant d’une réaction croisée entre le lait de vache et les viandes de mammifères comme le bœuf surtout, mais aussi le porc et le mouton.
Dans un article de Fiocchi et al., celui-ci indique que les patients allergiques au boeuf le sont aussi aux viandes ovines dans 50% des cas (Fiocchi, A. et al., 2000). Par ailleurs, Sicherer fait remarquer que 70% des patients allergiques au porc sont également sensibilisés au boeuf et 58% également au lait de vache (Sicherer, S.H. and Sampson, H.A., 1999)
Mamikoglu a pratiqué une étude sur 19 patients, âgés de 2 à 75 ans, allergiques à au moins un allergène alimentaire. Le but était de déterminer s’il y avait réactivité croisée entre le lait, le boeuf et le porc. Le degré de similarité entre les structures des albumines des différents animaux suggère que les patients sensibilisés par une espèce ont plus de chance de réagir avec des viandes de beaucoup d’autres animaux différents. Seize de ces patients étaient allergiques au lait ; 14 d’entre eux l’étaient aussi aux antigènes de porc et de boeuf. Seize patients étaient allergiques au boeuf et 13 de ces patients l’étaient aussi aux antigènes de porc.
Selon les résultats de cette étude, un patient allergique au lait est habituellement aussi allergique au bœuf. De plus, les allergènes du bœuf ont habituellement une réaction croisée avec les allergènes du porc.
La corrélation entre le lait de vache et le boeuf et aussi, à un degré moindre entre le lait de vache et le porc, est très forte et significative selon cette étude (Mamikoglu, B., 2005).
Dans leur article « Clinical reactivity to beef in children allergic to cow’s milk », Werfel et al. discutent le fait qu’une plus grande prévalence d’allergie au boeuf devrait être attendue (Werfel, S.J. et al., 1997) chez les enfants allergiques au lait. Ces deux aliments contiennent en effet la BSA, la BGG et d’autres protéines en quantité importante qui pourraient présenter cet effet allergénique chez certaines personnes et donc provoquer une allergie croisée. Dans cette étude, 8 enfants sur 11 réagissant à la viande de boeuf ont été diagnostiqués par le DBPCFC comme étant aussi allergiques au lait (Bindslev-Jensen, C. et al., 2004; Orhan, F. and Sekerel, B.E., 2003).Dans l’étude de Martelli et al. (2002), 92,9% des 26 enfants allergiques au boeuf étudiés présentaient également une allergie au lait de vache (Martelli, A. et al., 2002).
Par ailleurs, Bogdanovic et al. ont observé que les patients sensibilisés à la viande de boeuf et à la viande de porc et/ou au lait de vache sont susceptibles de l’être à la gélatine de porc et à la gélatine de boeuf (Bogdanovic, J. et al., 2009). A côté de ces réactions, on a constaté un grand nombre
A côté de ces réactions, on a constaté un grand nombre de cas d’association entre l’allergie au lait de vache et l’allergie au jus de soja.
Les allergies associées : lait de vache et soja
Il y a quelques dizaines d’années, le soja était considéré comme un substitut idéal de par sa soidisant faible allergénicité. De nos jours, certaines études démontrent le contraire. De plus, il semblerait qu’il y ait une certaine association entre allergie aux protéines de lait de vache et soja. Il existe très peu d’études à ce sujet mais elles ne sont pas à négliger (Restani, P. et al., 1999; Ahn, K.M. et al., 2003; Rozenfeld, P. et al., 2002).
Lors d’une étude française de Rancé et al. on a dosé les IgE anti-soja chez 65 enfants allergiques aux protéines du lait de vache. Les prick-tests cutanés au soja, réalisés au moment du diagnostic de l’allergie aux protéines du lait de vache, étaient négatifs chez tous les sujets. Lors du dosage a posteriori des IgE-spécifiques du soja, 8% des enfants toujours allergiques aux protéines de lait de vache après 5 ans (c’est-à-dire 25% du nombre d’enfants de départ) étaient positifs. Il n’a cependant pas été possible de préciser la sensibilisation antérieure aux protéines soja (Rancé, F. et al., 1998).
De même en Corée, la prévalence de l’hypersensibilité aux protéines de soja chez les enfants sensibles aux protéines du lait de vache a fait l’objet d’une étude, menée sur 1363 enfants et adolescents souffrant de dermatite atopique, d’urticaire, de syndrome entéropathique, d’asthme ou de rhinite allergique. La prévalence des allergies alimentaires aux différents allergènes dépendait en partie des différences régionales au niveau des habitudes alimentaires pendant l’enfance.
- Cette étude avait deux buts :
- Etudier la prévalence de la sensibilisation aux protéines de soja chez des enfants atopiques, sensibilisés aux protéines du lait de vache ;
- Etudier la prévalence de l’hypersensibilité aux protéines de soja non IgE-médiée associée, chez des enfants allergiques aux protéines du lait de vache.
Il a été constaté que sur 21 enfants allergiques aux PLV (allergie confirmée par histoire clinique convaincante et par disparition des symptômes après élimination alimentaire), 9 l’étaient aussi aux protéines de soja et 12 ne l’étaient pas.
Il est intéressant de savoir que, sur 224 sujets sensibilisés aux protéines du lait de vache (16,4% des sujets), 41 étaient aussi sensibilisés aux protéines de soja (pour un total de 74 enfants sensibilisés au soja parmi les 1363 étudiés) (Ahn, K.M. et al., 2003).
En 2002, une des protéines du soja, de poids moléculaire 30kDa, a été identifiée comme une molécule pouvant réagir de manière croisée et non associée avec les caséines du lait de vache (Rozenfeld, P. et al., 2002).
Tous ces résultats suggèrent qu’une réaction associée ou même peut-être croisée doit être prise en compte quand les patients allergiques aux protéines du lait de vache sont traités avec des dérivés du soja et qu’il est donc préférable d’éviter ces derniers.
Ceci est d’autant plus à prendre en considération que la fréquence de cette allergie semble être en augmentation dans le monde.
Prévalence de l’allergie aux protéines du lait de vache
Introduction
Tout comme lorsqu’on regarde les rapports de la FDA ou de la commission Européenne (Commission Européenne, D.g.I, 1997) sur les allergies alimentaires, peu d’études retrouvées ici sur la prévalence des allergies sont récentes. Etant donné le grand nombre de facteurs influençant le développement de cette pathologie, on peut supposer que les chiffres de son incidence sont en constante augmentation. Cependant, on peut aussi constater que la population perçoit souvent une allergie alimentaire alors que ce n’est parfois qu’une intolérance, une sensibilisation ou un autre phénomène moins ponctuel. Un article de Kirsten Beyer (Beyer, K. and Teuber, S.S, 2005) de 2005 reprend que 20% des individus décrivent une multitude réactions qu’ils pensent être associées à l’ingestion d’aliments.
La situation dans quelques pays
- Les données de fréquence de l’allergie sont très différentes d’une étude à l’autre. Plusieurs variables entrent en jeux :
- l’origine géographique de la population ;
- les habitudes alimentaires de la population ;
- la prédisposition génétique des personnes sur lesquelles les tests de diagnostic sont pratiqués ;
- l’âge moyen de la population étudiée ;
- la méthodologie (questionnaire,...) et/ou test de diagnostic utilisé ;
- les critères de diagnostic repris.
Tableau 4 :
Recensement des différentes études traitant de la prévalence de l’APLV
En plus de ces articles, deux revues de littérature ont pu être retrouvées : la première concernant l’incidence, la deuxième, la prévalence.
La première reprend 229 articles concernant l’APLV retrouvés sur Pubmed entre 1967 et 2001. Cette revue indique que l’incidence de l’APLV durant la première année de vie, mesurée au cours de différentes études menées entre 1973 et 1993, varie entre 1,8 et 7,5%, selon les critères de diagnostic et la méthodologie de l’étude. L’auteur retire de cette revue que l’incidence de l’APLV chez les enfants en bas âge est d’approximativement 2 à 3% dans les pays développés (Host, A., 2002).
La deuxième reprend les articles de la prévalence des allergies alimentaires retrouvés sur MEDLINE et EMBASE depuis 1990.
- On peut constater que, selon les 5 méthodes de diagnostic utilisées, la prévalence de l’allergie au lait de vache était de valeur variable :
- Self-reported food hypersensitivity : la variation de prévalence pour chaque étude allait de 1,2 à 17%.
- SPT ou dosage des IgE : l’écart de prévalence était de 0 à 2%.
- Test de provocation orale : il y avait une hétérogénéité entre les études basées sur le DBPCFC ou le test de provocation au lait. La prévalence pour le lait variait de 0 à 3%.
- SPT et dosage des IgE : la prévalence de la sensibilisation aux IgE variait de 2 à 9%. Les figures équivalentes pour le SPT étaient de 0,2 à 2,5% pour le lait (Rona, R. et al., 2007).
Selon le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, la prévalence de l’APLV chez les enfants se situe entre 1,9 et 3,2% (S.N., 2009).
D’après une étude anglaise d’une cohorte d’enfants âgés de 1 à 3 ans entre 2001 et 2002, 5 à 6% de ces enfants souffraient d’une hypersensibilité alimentaire. Les résultats ont été obtenus à partir d’un historique clinique approfondi et de tests de provocation orale. Les 3 aliments le plus souvent incriminés étaient le lait, les oeufs et les arachides (Venter, C. et al., 2008).
D’après l’enquête NHDS – National Hospital Discharge Survey (réalisée en 2007 par le NCHS – National Center for Health Statistics), 3 millions d’enfants Américains (3,9%) souffraient d’une allergie alimentaire (sans détail) (Branum, A.M. and Lukacs, S.L., 2008)..
Hormis les personnes présentant un diagnostic clinique et biologique d’allergie, on constate qu’un grand nombre de personnes avec des symptômes similaires à l’allergie se disent allergiques sans confirmation par des tests cutanés et biologiques.
L’auto perception en chiffres
Certaines recherches suggèrent que les croyances du public concernant les allergies alimentaires sont beaucoup plus élevées que les données de prévalence rapportées dans les études, telles que celles présentées ci-dessus.
En 1994, un questionnaire d’allergies alimentaires a été envoyé dans 15000 foyers anglais ( ~20000 personnes). 47% ont répondu ; 20% des 47% ont rapporté une allergie alimentaire. Sur 93 sujets qui ont subi un DBPCFC, 18 (19%) ont réagi positivement (Young, E. et al., 1994) (Young, E. et al., 1994).
De même, une étude a été entreprise pour déterminer les croyances du public américain concernant les allergies alimentaires en interrogeant une population large et équilibrée démographiquement (7500 ménages).
16,2 - 16,6 - 13,9% respectivement selon les dates de l’étude (1989, 1992, 1993) ont rapporté qu’au moins un individu dans le ménage présentait une allergie alimentaire. En 1989, le lait était l’aliment rapporté comme intervenant dans une allergie alimentaire à 29,3% ; en 1993, à 30,7%. Il semblerait que les personnes rapportant le plus d’allergies au lait dans cette étude soient des femmes (Young, E. et al., 1994).
Une étude (Eggesbo, M. and Botten, G., 2001) réalisée à Oslo sur la validité de la perception des parents concernant l’allergie de leurs jeunes enfants (âgés de 2 ans et demi) permet d’estimer la prévalence de l’allergie aux protéines du lait de vache.
- Selon le questionnaire complété par les 2721 familles, les enfants étaient répertoriés selon 3 groupes :
- Les enfants dont les parents ont perçu une réaction adverse au lait ;
- Les enfants dont les parents n’ont pas perçu de réaction au lait mais bien à d’autres aliments : ce groupe ne nous intéressant pas dans la situation qui nous concerne aujourd’hui ;
- Les enfants dont les parents n’ont perçu aucune réaction mais où des réactions chroniques étaient rapportées.
Le premier échantillon étudié se constituait d’enfants dont les parents ont perçu une réaction au lait. Les parents ont complété un questionnaire à 12 – 18 et 24 mois. Les parents ont rapporté une réaction adverse au lait pour 98 enfants à l’âge de 2 ans et demi.
Des 90 familles à qui il a été demandé de participer, 60% ont rempli le questionnaire.
- Sur les 54 enfants qui ont été examinés :
- L’allergie a été confirmée par dosage des IgE chez deux enfants, par test de provocation ouvert chez 2 autres et par DBPCFC chez 7 enfants ;
- Dans la troisième population, uniquement un enfant a été détecté par DBPCFC comme allergique au lait de vache.
Une étude menée en Turquie en 2006 a montré une grande différence entre les chiffres rapportés par les parents et les diagnostics confirmés en ce qui concerne les allergies alimentaires IgE-médiées dans une population d’enfants âgés de 6 à 9 ans. Le taux rapporté par les parents et/ou les enfants à l’aide de questionnaires annonçait une prévalence de 5,7% (156 sur 2739 enfants), contre une prévalence d’allergie alimentaire confirmée SPT puis DBPCFC de 0,80% (22/2739) ! Dans ce taux, l’APLV occupait la 2èmeplace, avec une fraction de 18,1% des 22 individus (Orhan, F. et al., 2009).
Une équipe colombienne a publié en 2008 une étude sur l’auto-perception des allergies alimentaires à Cartagena. Sur la sélection randomisée de 3099 individus (âgés de 1 à 81 ans), 14,9% (461) ont rapporté être allergiques à un ou plusieurs aliments. L’enquête a fait ressortir que 44 individus ont rapporté des symptômes d’allergie au lait (1,4% de l’échantillon) (Marrugo, J. et al., 2008).
Une étude finlandaise publiée en 2009 fournit la prévalence des hypersensibilités alimentaires perçues par les parents d’enfants âgés de 1 à 4 ans et des allergies alimentaires diagnostiquées dans la province de South Karelia, en Finlande. L’étude a porté sur tous les enfants appartenant à la tranche d’âge 1-4 ans en 2005 (4851 individus). La prévalence a été mesurée à l’aide de questionnaires adressés aux parents peu avant la visite médicale annuelle ; 70% des parents ont répondu. La prévalence d’allergies alimentaires diagnostiquées était de 9%, plus élevée chez les garçons que chez les filles et plus basse chez les enfants d’1 an que chez les autres. La prévalence d’APLV diagnostiquée et d’hypersensibilité au lait perçue par les parents était de 12,8% (respectivement 6,4 et 6,4%) (Pyrhonen, K. et al., 2009).
En fonction du type de réaction, ces allergies semblent être d’autant plus importantes chez les jeunes enfants et leur fréquence diminue chez les personnes adultes.
Les causes de l’allergie aux protéines du lait de vache sont identiques à celles des autres allergies alimentaires et peuvent être retrouvées dans le dossier général sur les allergies alimentaires.
Tout comme les chiffres de l’allergie aux protéines du lait de vache, ceux de l’intolérance au lactose semblent également augmenter au cours des années.
Prévalence de l’intolérance au lactose
La situation dans quelques pays
Il est très fréquent de retrouver des chiffres dans la littérature concernant la prévalence de l’intolérance au lactose selon les régions géographiques. Cependant, lors des recherches scientifiques, très peu d’articles reprenant l’étude de l’intolérance au lactose dans les différentes populations mondiales ont pu être retrouvés. Le tableau ci-dessous provient du site www.milkprocon.org et reprend les chiffres moyens de ce que l’on retrouve généralement. Par la suite, les différentes études retrouvées à ce sujet ainsi que les résultats seront développés et confrontés à ces données. Il faut aussi garder à l’esprit que le peu d’études retrouvées à ce sujet sont généralement anciennes et il est possible que les chiffres aient augmenté ou diminué de nos jours.
Tableau 5 :
Pourcentage de l’intolérance au lactose selon les régions géographiques
Sources :
1. Michael de Vrese "Probiotics: Compensation for Lactase Insufficiency," American Journal of Clinical Nutrition, Feb., 2001
2. Nevin S. Scrimshaw "The Acceptability of Milk and Milk Products in Populations with a High Prevalence of Lactose Intolerance," American Journal of Clinical Nutrition, Oct., 1988
3. National Institute of Child Health and Human Development "Lactose Intolerance: Information for Health Care Providers," NIH Publication No. 05-5303B, Jan., 2006
En général, on estime le nombre de personnes intolérantes au lactose dans la population mondiale adulte à 2/3 (Vesa, T.H. et al., 2000; Solomons, N.W., 2002). Dans un article de Heyman de 2006 sur l’intolérance au lactose chez les enfants et adolescents, il est repris qu’approximativement 70% de la population mondiale souffre de déficience primaire en lactase (Heyman, M., 2006). Lomer et al. confirment ce chiffre (Lomer, M.C. et al., 2008). Selon Heyman, seulement 2 % de la population de l’Europe du Nord, où il y a une prédominance d’une alimentation riche en produits laitiers, présente une déficience en lactase primaire, ce qui est bien inférieur aux chiffres retrouvés dans le tableau ci-dessus. Au contraire, la prévalence d’une déficience primaire en lactase est, selon cet article, de 50 à 80% chez les Hispaniques, 60 à 80% chez les Noirs et les Juifs Ashkenazi, et de presque 100% chez les Asiatiques et les Indiens d’Amérique (Heyman, M., 2006).
Il semblerait que l’âge d’installation et sa prévalence diffèrent parmi différentes populations. Approximativement 20% des enfants Hispaniques, Asiatiques et Noirs âgés de moins de 5 ans ont une déficience en lactase et malabsorption en lactose.
Certaines études ont été retrouvées afin de confirmer ces chiffres.
Une étude chinoise de Yang de 2000 avait pour but de déterminer le métabolisme du lactose et l’activité lactasique chez des enfants chinois d’âge différent. 1200 enfants avaient été recrutés dans des écoles gardiennes, primaires et secondaires dans 4 villes chinoises et dont les parents étaient natifs de ces villes (début en septembre 1997).
- Quatre-cents enfants étaient recrutés dans chaque groupe d’âge :
-
- 3-4 ans ;
- 7-8 ans ;
- 11-13 ans.
Dans cette étude, la déficience en lactase apparaissait principalement à l’âge de 7-8 ans et était détectée grâce à un test à l’hydrogène à 25g de lactose. La déficience était quasi la même dans le groupe des 11-13 ans. Ces résultats démontrent que l’activité lactasique peut commencer à diminuer vers l’âge de 3 à 5 ans et que les enfants chinois montrent une diminution ou une non-persistance de la lactase vers 7-8 ans. Dans les 4 villes étudiées, une différence dans la prévalence de la déficience en lactase a pu être observée. Il semblerait que la prévalence de l’intolérance soit plus élevée dans les villes du Sud que dans les villes du Nord. Dans cette étude, 31% du nombre total de sujets dans la tranche d’âge des 7-13 ans souffraient d’intolérance au lactose. 64% des sujets intolérants au lactose n’avaient que de très faibles signes cliniques dont les flatulences. 30 % se plaignaient de gaz, diarrhées et crampes et semblaient tolérer difficilement les 25g. 6% avaient de sévères diarrhées, crampes ou avaient beaucoup de douleur. La distribution des symptômes était similaire à travers les différents groupes d’âge (Yang, Y. and He, M., 2000).
Une étude réalisée en Italie en 1984 démontre que, sur 308 adultes sains (208 du Nord de l’Italie et 100 du Sud), 51% des sujets du Nord étaient intolérants contre 71% des sujets du Sud. Ceci confirme la tolérance plus importante des sujets dans le Nord comparé à la population du Sud (Burgio, G. et al., 1984).
Dans une étude réalisée sur 101 enfants iraniens sains âgés de 7 à 12 ans, le taux de malabsorption du lactose était de 64% chez les 7-10 ans contre 100% chez les 11-12 ans. On ne sait cependant pas si le terme malabsorption est utilisé pour une maldigestion du lactose ou de ses composants (Sadre, M. and Ghassemi, H., 1981).
Une étude réalisée en 1976 était la première à comparer la tolérance au lactose entre une population d’enfants Mexicano-américains et Anglo-américains âgés de 2 à 14 ans. Un test de tolérance et un rappel de 24h ont été réalisés pour chaque enfant. La prévalence de la malabsorption au lactose était de 37% chez les enfants Mexicano-américains et de 8% chez les Anglo-américains (Woteki, C. et al., 1976).
Une étude réalisée en 1977 sur une population d’enfants noirs âgés de 1 à 5 ans a montré que, sur une population de 116 enfants, 29% ont été diagnostiqués en tant qu’intolérants à la suite d’un test à l’hydrogène. Des symptômes identiques à ceux des intolérants ont cependant été retrouvés chez 12% des personnes tolérant le lactose (selon le test à l’hydrogène) (Paige, D. et al., 1977).
Une étude récente a étudié la prévalence de l’intolérance au lactose au sein d’une population de 231 adultes russes (âgés de 17 à 26 ans). La consommation de LV et de lait fermenté était estimée à l’aide d’un questionnaire. Pour diagnostiquer une éventuelle hypolactasie, les chercheurs ont déterminé le génotype des sujets par PCR (Polymerase chain reaction : technique d’amplification de l’ADN) à partir d’échantillons sanguins. La prévalence d’hypolactasie (génotype C/C-13190) était de 35,6%. Il a également été observé que, parmi ces sujets, 61,3% ne consommaient pas de lait ; leur consommation de lait fermenté était identique à celle des sujets tolérants au lactose (Khabarova, Y.A. et al., 2009).
On peut constater lors de la lecture de ces études qu’il existe plusieurs facteurs déterminant la fréquence de cette intolérance.
Les causes de la fréquence de l'intolérance au lactose
- Variabilité du pourcentage d’intolérance au lactose selon :
- Le lieu géographique et l’ethnie. De même la situation géographique Nord – Sud semblerait avoir son importance (Rusynyk R. and Still C., 2001; Benkebil, F. and Roulet, M., 2007; Mainguet, P., 2000) ;
- Les habitudes alimentaires : chaque ethnie ayant une culture différente, les habitudes alimentaires sont de même différentes. Le pourcentage d’intolérance est en relation avec l’utilisation de produits laitiers dans l’alimentation, elle-même variable selon la culture du pays et même des régions (Rusynyk R. and Still C., 2001; Yang, Y. and He, M., 2000) ;
- L’âge : il est observé dans les différentes études reprises ci-dessus que, selon le type d’intolérance, le pourcentage de personnes atteintes augmente avec l’âge. Cependant, il semblerait que les recherches sur ce sujet ne sont pas satisfaisantes pour confirmer cette hypothèse (Vesa, T.H. et al., 2000; Mainguet, P., 2000; Lebeuf Y. et al., 2002; Kerber, M. et al., 2007) ;
- Le sexe (Rusynyk R. and Still C., 2001) ;
- La sélection génétique (Benkebil, F. and Roulet, M., 2007; Rasinpera, H. et al., 2004; Hogenauer, C. et al., 2005)(Benkebil, F. and Roulet, M., 2007; Rasinpera, H. et al., 2004; Hogenauer, C. et al., 2005).
Symptômes de l’allergie aux protéines du lait de vache
Les symptômes de l’allergie sont vastes comparés aux symptômes de l’intolérance qui se présentent uniquement au niveau intestinal, ce qui peut d’ailleurs dans certains cas rendre difficile le diagnostic différentiel entre ces 2 pathologies.
Détails à consulter au CIRIHA
Symptômes de l’intolérance au lactose
A la différence des symptômes d’allergie aux protéines du lait de vache, les symptômes d’intolérance au lactose se répercutent principalement au niveau gastro-intestinal (Bahna, S.L., 2002) (Lomer, M.C. et al., 2008).
La majorité des sujets déficients en lactase sont asymptomatiques.
Chez le sujet intolérant symptomatique, les symptômes varient en fonction de la quantité de lactose ingérée et de mécanismes intestinaux encore controversés, liés au temps de transit, à l’activité lactasique de l’intestin grêle et à la fermentation lactique au niveau du côlon (Vesa, T.H. et al., 2000; He, T. et al., 2008a).
Détails à consulter au CIRIHA
Au cours de traitements de manufacture, l’activité allergénique d’une protéine contenue dans l’aliment traité peut être inchangée, diminuée ou augmentée.
- Différents processus technologiques peuvent induire :
- l’inactivité ou la destruction de la structure protéique ;
- la formation de nouveaux épitopes ;
- l’inactivité ou la destruction de la structure protéique ;
- l’amélioration de l’accessibilité d’épitopes cachés par dénaturation de l’allergène natif.
Détails à consulter au CIRIHA
Ingrédients laitiers et leurs propriétés technologiques, fonctionnelles : introduction
Depuis ces dernières années, le lait de vache ou, plus précisément, certains de ses constituants sont de plus en plus présents dans les aliments. En effet, le développement des moyens technologiques a permis de découvrir les propriétés fonctionnelles intéressantes, développées ci-dessous, des constituants du lait de vache. C’est pourquoi, nous observons, un développement d’aliments prêts à l’emploi sur le marché du commerce alimentaire (Cayot, P. and Lorient, D., 1998b ; Lebeuf, Y. et al., 2002).
- De nos jours, le lait peut donc être considéré non seulement comme un aliment mais aussi comme un ingrédient « poly-fonctionnel ». A ce sujet, il est utilisé dans les aliments :
- afin d’apporter des nutriments essentiels ;
- afin d’apporter de la structure à certains aliments ou en tant qu’additif (Cayot, P. and Lorient, D., 1998b).
- A l’aide de procédés technologiques divers, on parvient à isoler des protéines plus ou moins purifiées utilisées dans des applications alimentaires et non alimentaires :
- Des concentrés de protéines totales ;
- Des caséines et caséinates ;
- Des concentrés et isolats protéiques de lactosérum.
Remarque : la caséine, tout comme les protéines de soja, peut se retrouver dans le papier et le carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires humides et/ou grasses. En effet, l’AR du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (dernière modification : le 18 septembre 2008), Annexe IV, § III, point 3.2.3 précise que la caséine et les protéines de soja peuvent entrer dans la composition de ces matériaux à raison d’une dose maximale d’emploi en surface de 4g/m².
L’AR en question ne fournit malheureusement pas de liste de matériaux et objets à risque.
De même, les lipides complexes, le lactose et les minéraux peuvent être isolés pour utilisation technologique ou nutritionnelle dans certains produits.
Détails à consulter au CIRIHA
Tableau 3 :
Source : (Lebeuf, Y. et al., 2002 ; Cayot, P. an Lorient, D., 1998a ; Alais, C and Linden, G., 1997 ; FAO, 1995 ; Fredot, E., 2005 ; EFSA, 2007b)